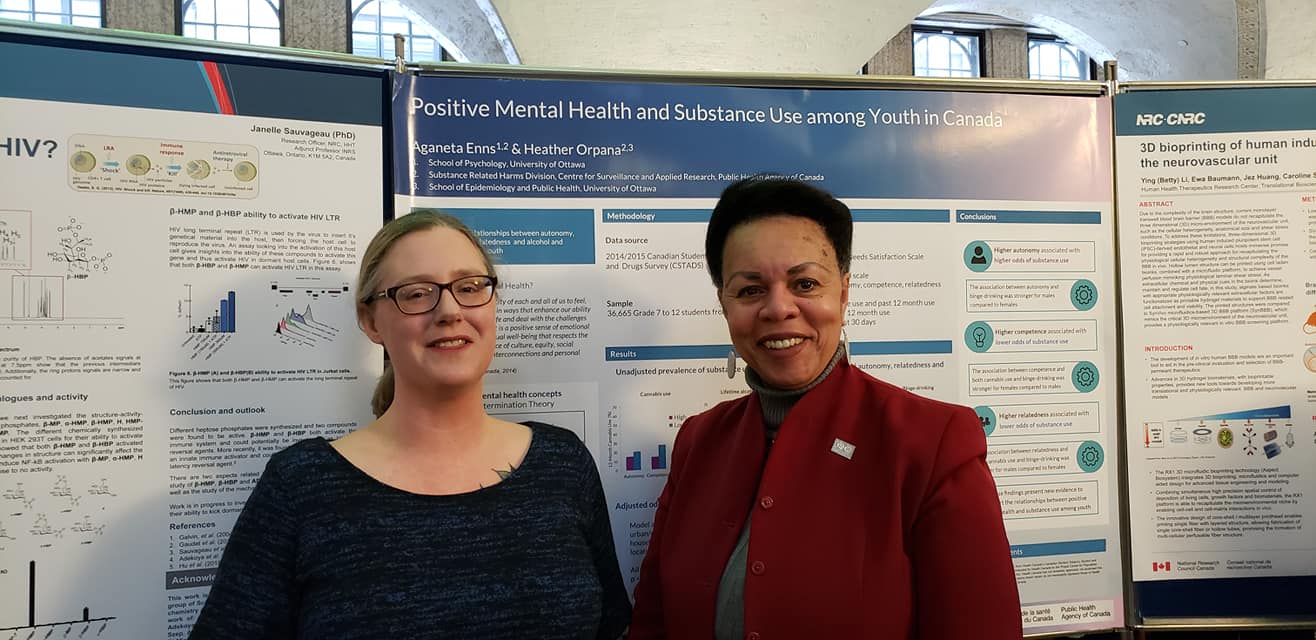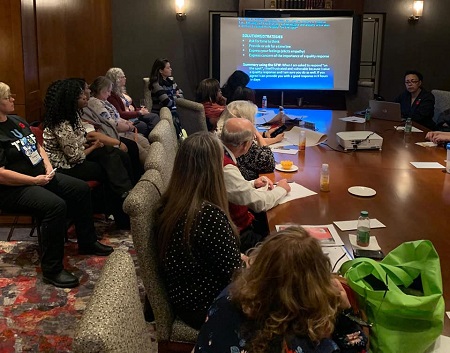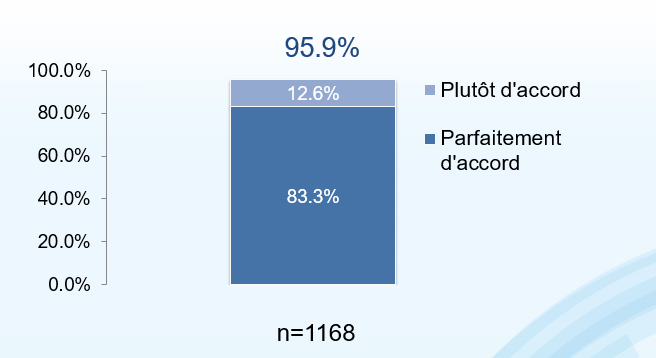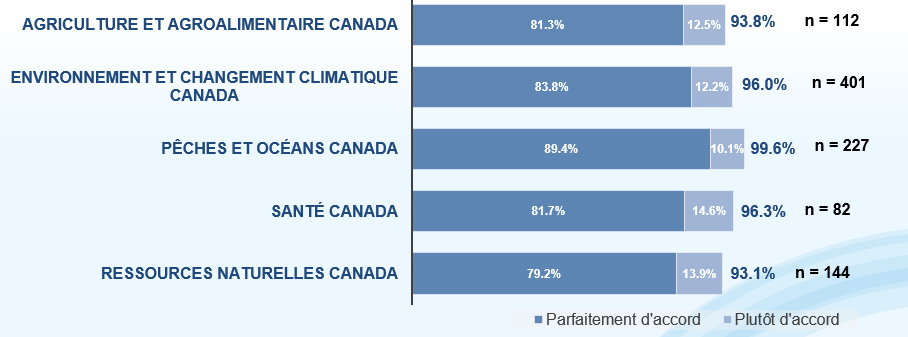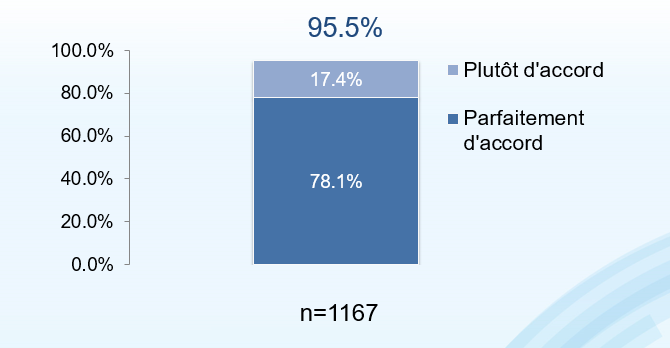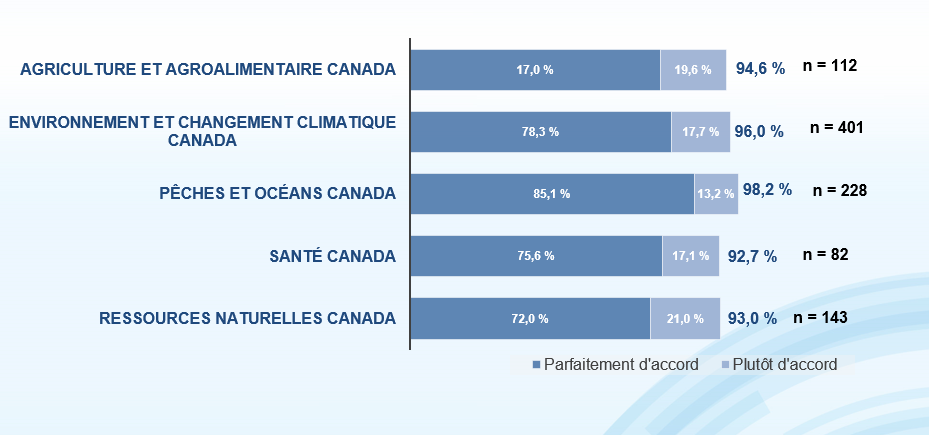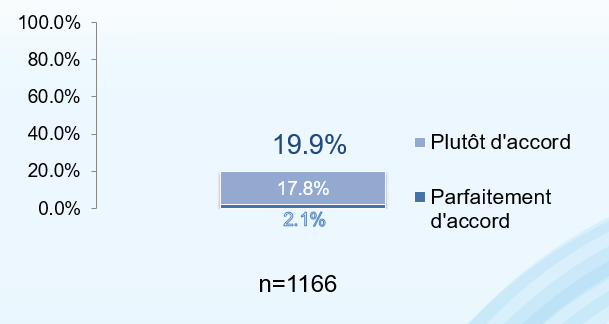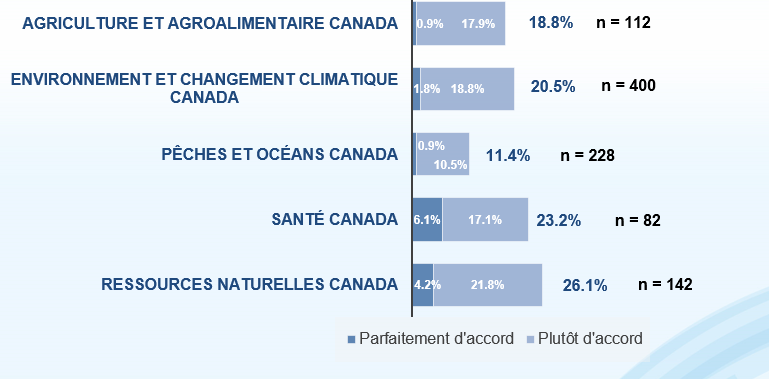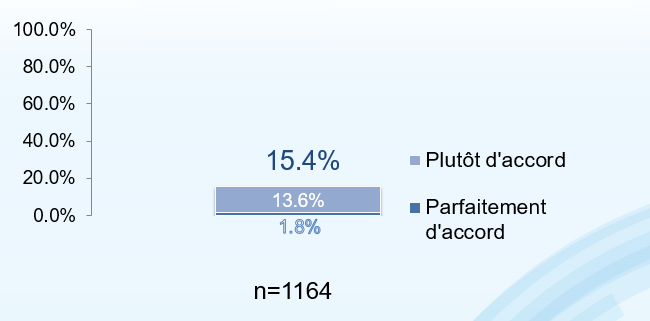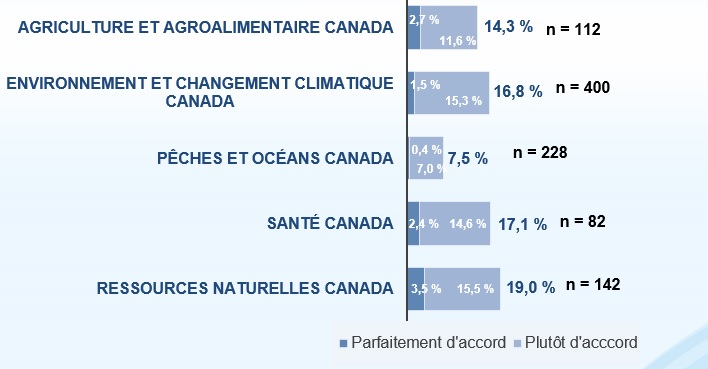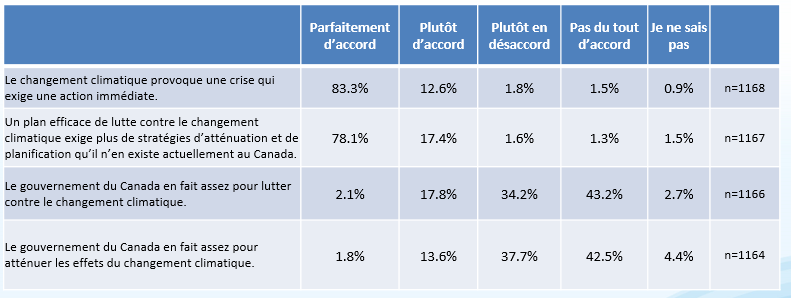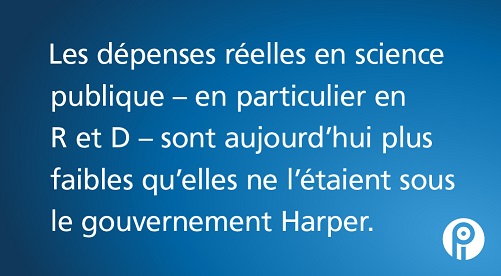En 2020, l’équipe Les femmes en science a mené un sondage pour connaître les expériences réelles en matière de congé parental et de congé pour obligations familiales dans le secteur public fédéral. L’équipe a interrogé des membres du groupe Sciences appliquées et examen des brevets (SP), du groupe Commerce et achats (CP), du groupe Architecture, ingénierie et arpentage (NR), du groupe Services de santé (SH) et du groupe Recherche (RE).
Elle a découvert un système défaillant, qui repose sur des décisions managériales improvisées, qui oblige le personnel à prendre des décisions impossibles et qui pénalise de manière disproportionnée les femmes et les personnes de la diversité de genre.
Ses conclusions mettent en évidence la nécessité de créer une culture qui valorise l’empathie et le travail à faire pour la créer. Il nous faut une culture qui favorise des lieux de travail inclusifs et conviviaux pour toutes les personnes ayant des responsabilités en matière de soins. Elles renforcent également notre position et ce que nous ne cessons de promouvoir : des lignes directrices meilleures et plus claires concernant le congé au code 699, les congés de maladie et le congé parental.
Nous savons qu’une bonne partie des questions soulevées par le sondage ne concerne pas que la fonction publique ou les groupes qui y ont participé. Nous encourageons tout le monde – nos membres, les employeurs, les autres syndicats et les décideurs à tous les niveaux – à lire le rapport complet.
Voici un aperçu des conclusions :
« J’ai choisi de ne pas avoir d’enfants, car j’ai l’impression que je ne pourrais pas répondre aux exigences de mon poste si j’avais un enfant ».
- En effet, 48 % des personnes interrogées sont préoccupées par les répercussions de leurs responsabilités familiales sur leur carrière.
- 34 % ont envisagé de retarder le moment d’avoir un enfant, de peur que cela ait un impact négatif sur leur carrière.
« J’ai été gestionnaire par intérim pendant quatre ans. Finalement, j’ai refusé le poste parce qu’il ne me laissait aucune flexibilité pour concilier mes responsabilités familiales et professionnelles durant la pandémie ».
- 41 % des personnes interrogées ont dit croire que le congé de maternité et le congé parental pouvaient avoir un impact négatif sur le cheminement de carrière.
- 22 % des personnes interrogées du domaine de la recherche ont indiqué que leur congé parental ou de maternité avait nui à leur financement.
« J’ai l’impression qu’il n’y a personne pour m’aider. À part parler à mon gestionnaire, je ne sais pas trop par où commencer. Mon employeur m’a donné très peu d’information ».
- Seulement 2 % des personnes interrogées ayant besoin de soutien ont déclaré avoir accès à des services de garde d’enfants au travail.
- Seulement 45 % pensent que les droits à un congé parental prévus à leur convention collective sont une mesure de soutien adéquate pour les familles et les nouveaux parents.
Prochaines étapes
Le congé pour soins est une priorité absolue pour les membres de l’IPFPC, et c’est pourquoi nous mettons sur pied une campagne à plusieurs volets pour aborder les problèmes révélés dans le sondage et pour faire avancer les recommandations formulées dans le rapport final. Nous commençons par l’information et la sensibilisation. Des webinaires sur les options de congé, la manière de s’en prévaloir et ce qu’il faut faire en cas de refus continueront d’être proposés aux membres.
Nous recueillons également des preuves en vue des négociations collectives. En commençant par le travail de l’équipe Les femmes en science, l’IPFPC étendra ses recherches à l’ensemble des membres, puis travaillera avec les négociatrices et négociateurs et les équipes de négociation pour élaborer les propositions fondées sur des preuves dont nous avons besoin pour étayer et défendre efficacement ces questions à la table des négociations.